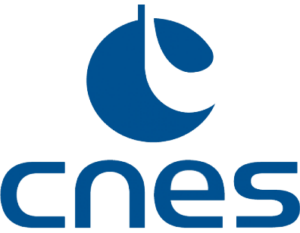Le réseau FRIPON, dont la finalité est de retrouver des météorites fraichement tombées, réalise une surveillance continue du ciel pour détecter les bolides qui signalent les chutes de météorites et les retombées atmosphériques de débris spatiaux et, plus généralement, tout phénomène lumineux. Il est constitué à l’heure actuelle de 175 caméras « all sky » couvrant toute la France et une fraction de plusieurs pays européens (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-Uni, Suisse). Le réseau comporte également quelques caméras en dehors de l’Europe ainsi que 25 récepteurs radio (GRAVES) couvrant toute la France. Les données sont stockées et traitées à l’OSU Pythéas et alimentent des bases de données utilisées par plusieurs agences et par les communautés scientifiques nationales et internationales. Une description plus détaillée du programme FRIPON est accessible sur le site https://www.fripon.org.
En cas de chute de météorite, les données du réseau FRIPON permettre de définir l’ellipse de chute et ainsi d’orienter les recherches sur le terrain.
Membres de l’équipe GSP impliqués dans FRIPON:
Pierre Vernazza, Laurent Jorda
SNO FRIPON (ANO6):
ANO6 FRIPON